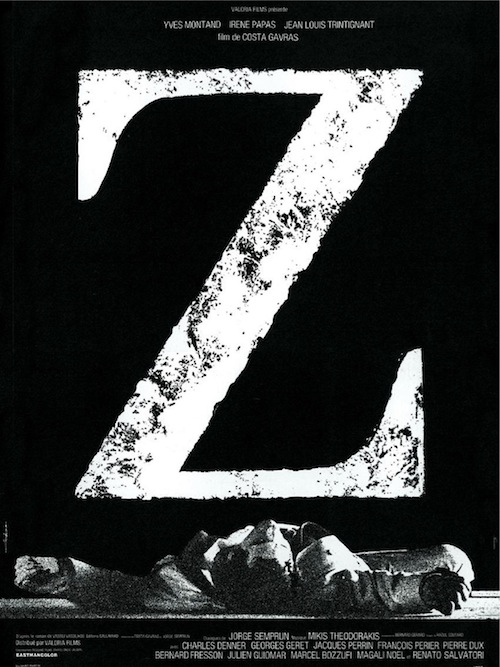I
Tamoul maboul !
Lingesh, bodybuilder, n’a qu’un seul rêve, celui de devenir « Mister Inde ». Obsédé par Diya, une top-modèle spécialisée dans le tournage de publicités, il parvient à se faire embaucher pour tourner dans un film publicitaire à ses côtés. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu…

Qui aurait cru que le titre le plus court de l’histoire du cinéma serait attribué à l’un des rares films à savoir combiner tous les genres cinématographiques sur une durée-fleuve ? C’est pourtant ce qui s’est produit avec "I", superproduction de 3h08 en langue tamoul et réalisée par le nouveau roi de Bollywood (S. Shankar, à qui l’on doit déjà le méga-succès futuriste "Endhiran"). Autant mettre sur les points sur les « i » (rires) : même si la recette gagnante d’un blockbuster à la sauce Bollywood ne variera pas ici d’un iota, cette pellicule hallucinante à laquelle nos orbites se confrontent ne doit son éblouissante réussite qu’à l’envie d’en pousser la logique de chacun des ingrédients jusqu’au point de non-retour, le tout avec un premier degré bienvenu et un refus total du cynisme contemporain. Ce qui en résulte est une définition assez parfaite de ce que l’on appelle un « divertissement » : pas de logique figée dans le script, pas de limite dans les idées, pas de temps mort dans le rythme, juste un effet de surprise qui se relance toutes les trente secondes pour mieux stimuler et épuiser son audience. Et gare aux effets secondaires !
Une seule lettre, donc, à la signification triple : le nom d’un spray pour lequel les deux héros tournent une publicité, le nom d’un mystérieux virus qui va causer bien des soucis à l’un d’eux et surtout une lettre de l’alphabet tamoul qui signifie « beauté ». Le scénario, aussi imprévisible que parfaitement structuré, met un point d’honneur à justifier tout ce qu’il fait intervenir comme éléments, qu’il s’agisse des enjeux dramatiques, des thèmes ou des idées graphiques. On pourrait le résumer simplement en parlant d’une histoire d’amour entre un ancien bodybuilder et une top-modèle sexy qui tournent des publicités en couple, mais ce serait trop court, tant le film accumule les sous-intrigues et les ruptures de ton à la vitesse d’un supersonique. Disons qu’on a surtout affaire à une sorte de conte de fées naïf et loufoque, à travers lequel Shankar n’hésite pas à foncer tête baissée dans la démesure graphique. C’est du cinéma qui assimile l’improbabilité comme la seule et unique « probabilité », qui vise à mélanger les tonalités de chaque genre plutôt que de les isoler chacune dans leur coin. Avec, bien sûr, une vraie composante musicale qui se voit reliée de façon parfaite à l’intrigue.
Libre comme l’air, Shankar fait donc péter toutes les couleurs de l’arc-en-ciel dans chaque scène, utilise un symbolisme volontiers too much pour quitter la stratosphère du sérieux, ne prend jamais peur devant le ridicule à force de l’absorber par le biais d’une inventivité visuelle inouïe (voir ces scènes où l’héroïne devient télévision, haltère, moto, poisson, mousse de savon, téléphone Nokia, etc.), quitte les lois de la pesanteur par des loopings aériens que n’aurait pas renié Tsui Hark (grande scène de wu xia pian sur des maisons chinoises, où les BMX remplacent les sabres !), exploite le plan-séquence et les mouvements de caméra lorsque la narration le justifie, met au cube le nombre de décors pouvant être utilisés dans un film (on a parfois l’impression que le globe entier défile à l’écran !), subvertit son regard sur l’univers de la publicité par des idées de découpage très malines, et (ab)use d’un humour on ne peut plus débile afin d’assumer clairement la folie ininterrompue de son intrigue. À ce stade, ce n’est même plus un film que l’on regarde. Il faudrait inventer un nouveau mot.
À bien des égards, si vous faites partie de ceux qui n’adhèrent pas à un cinéma indien à gros budget soi-disant trop kitsch et ridicule, "I" a tout ce qu’il faut en main pour vous faire changer d’avis. Ce qu’offre ce film n’est pas seulement une qualité de fabrication irréprochable à tous les niveaux (notons que les maquillages prosthétiques du film sont dus aux génies néo-zélandais de Weta Workshop), mais avant tout un goût pour la démesure et la jouissance sensitive immédiate. Ce qui nous pousse alors à lâcher prise avec le réel et à se laisser gagner par le vertige de l’imprévu, durant 188 minutes qui passent comme un éclair. Au final, ce film-expérience unique en son genre n’a même pas besoin d’être analysé. Il faut juste le vivre, c’est tout.
Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur