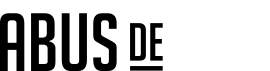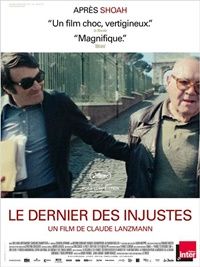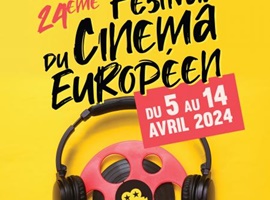LE DERNIER DES INJUSTES
Nouveau(x) regard(s) vers le passé

Le problème avec le cinéma de Claude Lanzmann ne varie décidément pas d’un iota : si les informations relevées par l’auteur et la richesse documentaire de son périmètre d’investigation ont de quoi forcer le respect le plus absolu (surtout en ce qui concerne un sujet aussi délicat que l’Holocauste), son travail de cinéaste a en revanche de quoi laisser dubitatif, ne serait-ce qu’au travers d’un impact stylistique proche du degré zéro. On le pressentait déjà, mais au-delà de leur importance capitale pour tout citoyen qui souhaite effectuer son devoir de mémoire, "Shoah" et maintenant "Le dernier des injustes" ont clairement du mal à trouver un véritable impact dans une salle obscure.
Comprenons par là que ces deux documentaires se limitent à une suite d’interviews et de rushes rallongés au maximum, sans grande attention portée au cadre ou au découpage, reléguant le résultat moins au rang d’œuvre de cinéma réellement travaillée que de document d’archive hautement salutaire. Dommage, car si on voulait voir du cinéma et pas une Thema d’Arte, tenir l’écoute durant les 220 minutes de ce nouvel opus ne sera pas facile.
D’entrée, les similitudes avec "Shoah" ne sont pas hasardeuses : ce que révèle ce nouveau film réside dans des dizaines d’heures de rushes inédits que Lanzmann a accumulées pendant tout son processus d’enquête. Ses entretiens avec Benjamin Murmelstein enchaînent donc de nouvelles et terrifiantes informations (celles sur la vraie personnalité d’Adolf Eichmann et le concept de « banalité du mal » par Hannah Arendt sont hallucinantes), tout en offrant à cet interlocuteur ô combien fascinant de révéler ses aptitudes de conteur : on y découvre un vieil homme bavard et non dénué d’humour, en tout cas humain malgré tout et conscient d’avoir été la marionnette du régime nazi. Lanzmann ne le lâche jamais, l’invite au détour de chaque échange à triturer chaque zone de sa mémoire, et n’hésite pas à l’interpeller à la moindre contradiction. Et le dialogue, d’abord glacial et méfiant, devient peu à peu chaleureux, axé sur un pied d’égalité rassurant.
Le souci, comme on l’évoquait plus haut, c’est la longueur. Persistant dans son désir de ne jamais lâcher son sujet jusqu’à obtenir ce qu’il cherche (un raccourci exemplaire du travail de journaliste), Lanzmann impose une fois de plus la longue durée (ici 3h40) pour que la vérité finisse par jaillir du dialogue. Mais trop souvent, cela génère de la difficulté. Parce qu’on peine à s’intéresser autant à un sujet, aussi fort soit-il, lorsqu’un dispositif scénique ou une mise en scène de cinéma pointent aux abonnés absents. Parce que la seule option de mise en scène se limite à voir Lanzmann se filmer en plan fixe pendant plus de dix minutes en train de lire un papier où sont recensées les souffrances des déportés. Parce qu’au bout du compte, on a tout simplement la sensation qu’une telle œuvre aurait gagné à être resserrée dans un montage plus compact (il n’y a qu’à voir les derniers films de Rithy Panh pour en prendre le pouls), voire à se diviser en plusieurs segments destinées à une émission télévisée. Dommage.
Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur