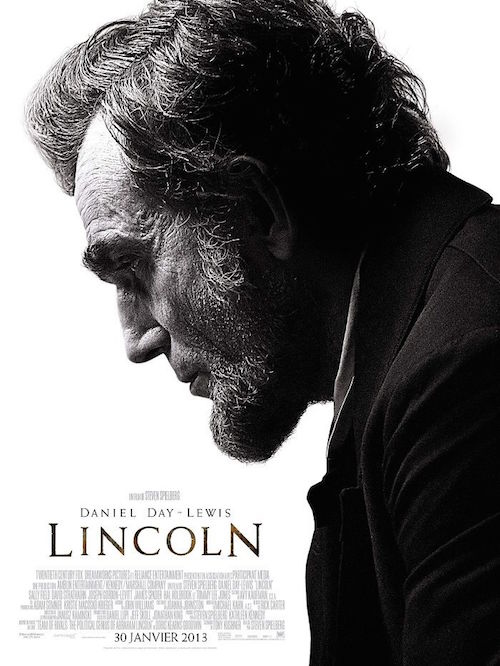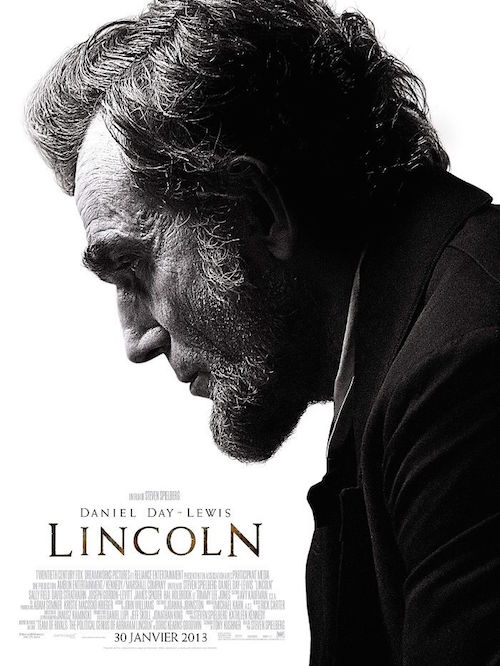LINCOLN
Portrait de Lincoln à la fin d’une guerre si vile
En 1865, aux États-Unis, la fin de la guerre de Sécession approche et Abraham Lincoln s’apprête à prêter serment pour un second mandat. Avant que la nouvelle Chambre des représentants ne rentre en fonction, le président voudrait faire passer une loi chère à ses yeux : le 13e amendement à la Constitution rendant à tous les esclaves leur liberté, la suite logique à sa Proclamation d’Émancipation édictée le 1er janvier 1863. Mais pour cela, il faudra convaincre les deux tiers des représentants de voter en faveur du texte, et convaincre quelques-uns des très réticents démocrates…

La légende dit qu’au moment de signer la Déclaration d’émancipation des esclaves, Abraham Lincoln fit mine d’hésiter. À quelqu’un qui lui demandait pourquoi cette tergiversation, le président rétorqua : « Je prends mon temps parce que si l’on voit à ma signature que j’ai tremblé, on se dira que j’ai eu des doutes ». L’Histoire, on le voit, possède son propre poids, parfois insoutenable. Et Lincoln, tout entier à son souci de laisser à ses concitoyens un héritage gravé dans le marbre, ne pouvait se permettre d’esquisser un geste qui ne fût pas sentencieux. À l’heure d’enregistrer les premières prises de vues de son « Lincoln », hommage filmique au grand homme et au parcours menant au fameux paraphe, Steven Spielberg semble avoir éprouvé une même affectation : de crainte de trembler, il a jugé bon de ne prendre aucun risque. Et le résultat, c’est un long-métrage certes instructif et solennel, mais didactique et quelque peu falot.
La promesse était trop belle pour ne pas décevoir. Le 16e président des États-Unis colle à la peau du plus doué des réalisateurs de sa génération depuis que, tout jeune, Spielberg découvrit la majestueuse statue d’ « Honest Abe » assise sur son trône du Lincoln Memorial, face au Capitole, à Washington. Bien des années plus tard, alors qu’il s’imagine déjà travailler à un vaste projet lincolnien, il tombe sur un ouvrage de Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals, détaillant les relations conflictuelles entre Lincoln et son cabinet, depuis son intronisation jusqu’à la fin de la guerre de Sécession. Il en achète illico les droits et se fait remettre par Tony Kushner, son scénariste de « Munich », un premier traitement de 500 pages, et en sélectionne 70.
Spielberg choisit de s’intéresser aux stratagèmes politicards qui permirent aux républicains de s’assurer le concours de la fraction majoritaire de la Chambre, jusqu’au jour du vote, le 31 janvier 1865. Son récit repose sur une base triangulaire : le lent processus de conviction politique des élus, la guerre qui entre dans sa dernière phase, et la gestion de ses propres difficultés familiales. Spielberg délaisse délibérément l’aspect proprement guerrier pour se concentrer sur ses conséquences humaines, et en faire un enjeu à la fois de la sphère politique et de l’intimité du foyer. Hormis les plans d’ouverture qui nous plongent au cœur d’un affrontement violent et boueux, le conflit est en effet mis en sourdine : car ce n’est pas la guerre qui intéresse le réalisateur, sinon sa dramatique nécessité, son impérieuse existence.
Malheureusement, c’est trop rarement que l’on retrouve ce génie spielbergien de l’image, celui qui, dans le récent « Cheval de guerre », s’avérait capable de transformer la trajectoire d’un canasson en allégorie de l’humanité en marche. Passé un superbe prologue qui souligne l’humilité et la prestance du grand homme, et quelques séquences d’une puissance émotionnelle indiscutable, il faut avouer que ce « Lincoln » manque cruellement de cette audace visuelle qui a fait les beaux jours du cinéma de Spielberg. Confronté à une Histoire trop lourde, parce qu’elle est pleine d’un héritage tout contemporain (la question de la place des minorités dans la société), Spielberg ne réussit qu’à reproduire des faits quand il aurait dû leur donner de l’ampleur et la pédagogie semble l’avoir emporté sur le style. La mise en scène est souvent étriquée, presque timide, et les grands éclats sur la liberté et l’esclavagisme rappellent les passages les plus ennuyeux de l’autre « film en Chambre » de Spielberg, « Amistad ».
Ce qui fera néanmoins le succès de « Lincoln », c’est l’exactitude de son récit et la remarquable pertinence de son casting. Daniel Day-Lewis offre une prestation magistrale, et à son habitude, il montre comment, à force d’implication, il est parvenu à trouver la tonalité parfaite, jusque dans cette voix traînante, trompeuse, que l’on ne peut pas reconnaître faute de posséder un enregistrement vocal de Lincoln, mais qui matérialise les attentes de l’imaginaire collectif. Autour de lui, quantité de seconds rôles font plus que leur boulot : David Strathairn en vice-président William Seward, tout entier à la cause de son chef ; Sally Field en épouse à la fois forte et délicate ; Tommy Lee Jones en brillant représentant de Pennsylvanie ; Jared Harris à son aise dans le costume du général Ulysses S. Grant, commandant des armées unionistes et futur 18e président du pays. Enfin, Hal Holbrook, interprète de Lincoln dans une mini-série de 1974, et qui joue ici Preston Blair, républicain proche des Confédérés qui fut à l’origine de la rencontre avec les émissaires de Jefferson Davis afin de trouver une sortie au conflit.
C’est sans doute là le problème de ce « Lincoln » : que paradoxalement, on y croit trop. Que la respectable reconstitution de l’époque, de ses questionnements moraux et de ses enjeux politiques soit totalement soumise à un canevas basé sur l’historicité et l’authenticité, sans laisser aucune place, ou presque, à la liberté de la mise en scène ou aux envolées lyriques dictées par le Progrès. On devine que la chandelle est trop importante pour que Spielberg s’autorise à jouer avec son matériau, et que son film a d’abord le dessein de ressembler à une leçon vertueuse, destinées aux générations à venir, avant d’être une œuvre de fiction – le discours sous-jacent nous invitant à reconnaître le vote du 13e amendement comme la première marche d’un haut escalier menant aux droits civiques cent ans plus tard, puis à l’élection récent d’un président noir. Mais on s’attendait à ce que la leçon spielbergienne fût moins sclérosée, et qu’elle s’apparentât plus à un flamboyant manifeste pour l’égalité des droits et moins à un terne chapitre de livre d’histoire.
Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteurBANDE ANNONCE