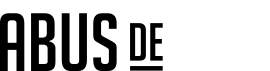CHIEN BLANC
S’impliquer pour l’autre
En avril 1968, Romain Gary, écrivain, alors consul de France à Los Angeles, et sa femme, Jean Seberg, apprènent par le discours télévisé de Robert Kennedy la mort de Martin Luther King, par assassinat. Peu après, lui et son fils recueillent un chien qu’ils découvrent dressé pour attaquer les Noirs : un chien du sud, appelé « chien blanc ». Refusant de s’en débarrasser, il va tenter de le faire dresser…

"Chien Blanc" débute sur une interview de Romain Gary, alors consul de France à Los Angeles, s'interrogeant sur sa « situation d'homme blanc ». Un sujet qui va finalement parcourir l'ensemble du nouveau film de Anaïs Barbeau-Lavalette, réalisatrice canadienne connue en France pour avoir mis en scène "La Déesse des mouches à feu". Envahi peu à peu par l'embrasement social du pays, suite à la mort de Martin Luther King, grâce à des montages ponctuels d'images d'archives, montrant émeutes et répression, manifestations de blancs et du Ku Klux Klan, arrestations et violences policières, sur fond de chants lyriques ou de chansons d'époque, le film nous plonge dans la lutte pour les Afro-américains, le film pose en filigrane la question de la possibilité de faire changer quelqu'un de raciste (ici le chien...) et interroge surtout sur la possibilité pour les blancs de sympathiser, aider ou faire partie des mouvements anti-racisme.
Grâce au personnage de Jean Seger, actrice célèbre de la Nouvelle Vague (interprétée avec justesse par Kacey Rohl), connue pour son engagement avec les Black Panthers, le métrage tente d'exposer la difficulté à épouser la cause des autres. Si le film paraît aujourd'hui d'autant plus nécessaire, il ne convainc pas totalement, la faute à des dialogues et mises en situation qui font apparaître le personnage de Denis Ménochet comme manquant d'interaction avec les autres, ou à un développement des tensions internes au couple qui reste minimal. Reste cependant un point de vue, sur le risque de dévoyer une cause en se substituant à ceux concernés (la scène où Jean Seberg donne une interview lors d’une lutte pour l’égalité d’accès à l’université est particulièrement significative...), entrecoupé de scènes qui font froid dans le dos (les ralentis sur des enfants, coursés par le chien ou par de jeunes Blancs...), et la sensation que le travail de dialogue à avoir est encore grand.
Olivier BachelardEnvoyer un message au rédacteur