2012
Les derniers jours du monde
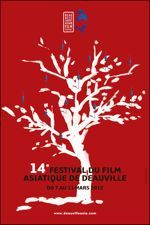
Au cinéma, ce peut être la fin du monde plusieurs fois par an. Est-ce la proximité de l’année maudite – 2012 – qui fait que l’humanité ne cesse désormais de s’éteindre par écran interposé quand, les décennies précédentes, elle se contentait de perdre plusieurs millions de ses membres ? Le sujet est en tout cas porteur. En 2h40 de péripéties improbables et de catastrophes inexorables, conséquences de perturbations géologiques profondes, Roland Emmerich transforme la Terre en poudrière et l’humanité en vestige.
Le « Grand Destructeur » qui, une fois n’est pas coutume, envoie au diable la Maison-Blanche (que dirait Freud de cette mauvaise habitude ?) alterne entre deux points de vue : celui d’un romancier peu glorieux (Cusack) qui tente de mettre sa famille éclatée à l’abri (dont son ex-femme, interprétée par Peet) et celui des autorités compétentes, incarnées par le président des USA (Danny Glover, prenant le relais de Morgan Freeman comme chef d’Etat cinématographique de couleur), sa fille (Newton), le secrétaire général de l’administration (Platt) et le conseiller scientifique spécial (Chiwetel Ejiofor). L’incessant va et vient entre les deux entités participe d’un grand yo-yo humanitaire, au centre d’un joyeux fourre-tout de destructions massives.
John Cusack, en plus de confirmer son statut d’outsider talentueux du cinéma hollywoodien, éclaire de son aura les excellents choix de casting faits par Emmerich. Face à tant de situations invraisemblables et de fariboles scientifico-mystiques, il reposait sur les épaules des comédiens de nous donner à croire à la destruction du monde, de nous convaincre de sa possibilité sinon matérielle, du moins humaine. Cusack / Curtis est un médiocre romancier de science-fiction – tiens ! comme dans le récent « Un enfant pas comme les autres » – dont un livre se retrouve tout à fait par hasard embarqué avec ces chanceux qui pourront survivre à la catastrophe. Il y a beaucoup de « La Guerre des mondes » dans la relation qu’entretient Curtis avec son ex-femme et ses enfants, mais sans le sourd pessimisme qui clôturait le chef-d’œuvre de Spielberg, dissimulé derrière une feinte image d’Épinal.
Au milieu de tant d’œuvres d’art consciencieusement conservées – tableaux, sculptures, ouvrages phares de l’humanité – la présence du livre profane de Curtis, d’une qualité discutable, mais plein d’une honnêteté naïve, fait dire à Adrian Helmsley que derrière un tel hasard pointe un miracle discret qui fait tout le sel de l’Homme. Et permet à Emmerich de transformer son arme de destruction massive en plaidoyer pour l’humanité, sur un mode toutefois plus candide que celui d’un Voltaire dans son conte « Le monde comme il va », dont les dernières lignes, on s’en souvient, comparaient l’Homme a une sculpture faite de pierres précieuses autant que de scories.
En ce sens, « 2012 » est aussi une réponse – peut-être pleinement consciente – au « Jour d’après », dont il recopie méticuleusement le schéma narratif : dans ce dernier les protagonistes y jetaient les livres au feu afin d’échapper aux mordantes griffes du froid, choisissant de brûler Nietzsche plutôt que la Bible de Guttenberg. Dans « 2012 », au contraire, les écrits d’un écrivain sans grande valeur côtoient les rayons des œuvres lumineuses de l’Histoire, prouvant ainsi que la plus infime individualité mérite d’être sauvegardée au même titre que la plus respectable des créations.
Synthétiquement, on pourra reprocher à « 2012 » une foule de défauts très ou trop hollywoodiens : un film naïf, accusant des longueurs, ne cachant par un américano-centrisme accentué, parsemé de personnages bouffis d’archétypes, et où l’on sauve – sic ! – encore une fois le petit chien, comme aux plus mauvaises heures d’ « Independence Day ». Certes. Mais bon sang, que c’est bon d’assister à la disparition quasi-complète de la Californie dans la gueule béante de la couche terrestre ! Qu’il est suave de constater la tentation universaliste d’Emmerich qui, par acquis de conscience, accumule les protagonistes ethniquement opposés, formant un melting pot culturel !
Alors, de deux choses l’une : soit je me métamorphose petit à petit, et tout à fait inconsciemment, en amateur imbécile de l’obésité culturelle américaine, dont les bons sentiments dégoulinent par tous les pores ; soit le cœur graisseux d’Emmerich dissimule un vrai plaisir de cinéaste qui transpire à l’écran et fait plaisir à voir. Finalement, la meilleure caractérisation de ce film tient en une métaphore simple : « 2012 » est tout comme le volcan Yellowstone, réveillé par les ronflements de la planète; tandis qu’il explose en volutes étouffantes et en scories mortelles, on observe de loin la grande beauté de sa colère.
Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteur



